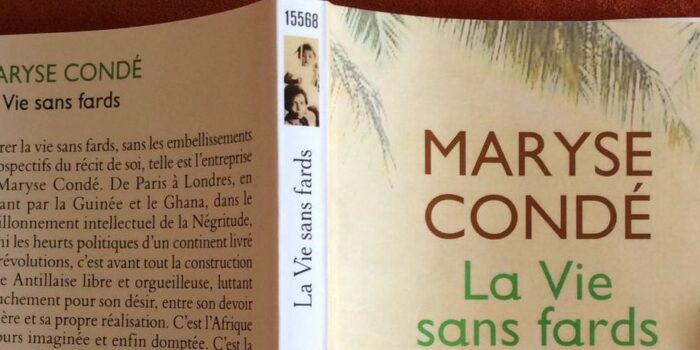En 2011, Marc Cheb Sun, directeur de D’ailleurs et D’ici, rencontrait Maryse Condé à son domicile…
Mon interview de Pascal Blanchard: « Un vocabulaire colonial très sexuel »
Pascal Blanchard publie ce mois Sexe, race et colonies (co-dirigé avec Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Christelle Taraud et Dominic Thomas) aux éditions La Découverte. Historien spécialiste des histoires coloniales, l’auteur a écrit et dirigé plusieurs ouvrages qui font date (Le Paris arabe, La Fracture coloniale, La France noire, La République coloniale ou Exhibitions. L’invention du sauvage…) ; ainsi que plusieurs documentaires-référence, dont Noirs de France, Paris couleur ou Les Bleus. Une autre histoire de France, et séries télévisées Frères d’Armes, Champions de France & en 2017 Artistes de France sur toutes les chaines de France Télévisions.
Vous publiez un ouvrage consacré à la vision du corps, de l’empire colonial au postcolonial, ouvrage suivi en 2019 d’une exposition…
Sur ce sujet, il existe une vingtaine d’expositions importantes mais aucun projet global, elles sont toutes sur des thématiques spécifiques ou des artistes particuliers. Nous avons donc décidé d’inviter plus de 80 auteurs à participer à l’ouvrage Sexe, race et colonies. Notre fond iconographique de référence, de 70 000 à 80 000 images, nous permet d’imaginer une grande exposition en 2019, mais aussi d’élaborer un travail d’anthologie pour le catalogue. Le point de départ est le suivant : on ne peut comprendre le rapport colonial et ses héritages contemporains sans s’intéresser au corps, à la sexualité, à l’érotisme, aux fantasmes, aux violences qui lui sont liés. Nous souhaitons mettre en lumière une cohérence historique et esthétique à ces cinq siècles d’histoire. C’est pourquoi nous pouvons aussi bien parler des prostituées coréennes dans l’armée japonaise que du discours sexuel rattaché aux femmes aborigènes ou enfin, de la vision projetée sur les femmes indiennes par les trappeurs français du XVIIe siècle au Canada. Ce qui lie ces récits, des premières représentations sexuées de Noirs au Portugal en 1553 aux créations d’artistes contemporains tels Mappelthorpe ou encore Ayana Jackson, c’est un discours colonial très spécifique. Ce discours s’accompagne de notions de domination et participe à la construction et à l’invention du corps. Le sexe y est presque systématiquement évoqué, tantôt dans une dimension utilitaire, tantôt sous l’apparat d’une offrande. Les affiches produites en sont un bel exemple ; elles invitent consciencieusement à la consommation de cette dernière ; cela fait partie de la mythologie. En parallèle, un discours anti-métissage se développe dans toutes les capitales coloniales. Désir et interdit se côtoient, c’est ainsi que l’on rend attirante les colonies et que l’on fabrique un désir de domination.

Un interdit qui renvoie à une domination…
Oui, mais c’est plus complexe. Au XVe siècle déjà, les premières représentations d’Indiens, d’Africains au Portugal montrent une érotisation dans les dessins avec des corps musclés pour les hommes et des postures offertes pour les femmes. Cependant, nous pouvons évoquer le Code noir comme un exemple significatif de cette mécanique coloniale puisqu’il ne cesse de parler d’interdit sexuel, et de violences. Cette mécanique coloniale se situe donc dans cette pluralité de discours. En arrière plan, on trouve un discours scientifique qui prévient le danger que produirait une sexualité non contrôlée, les métis ; et qui met ainsi en place l’interdit du couple métissé. Il y a aussi le discours des romans populaires au XIXe qui esthétisent un exotisme sexué, inconcevable avec des Blanches ; ou encore des discours esthétiques, érotiques ou pornographiques. Ce dernier se développe dès 1880 et convoque une fascination : la colonie. C’est en effet le seul endroit où l’autre peut être désirable tout en étant violenté, détruit dans son corps. Dans l’esclavage par exemple, la sexualité est plus que liée à la domination puisqu’elle implique une place dans la hiérarchie. L’esclave sexuel n’est plus aux champs, elle n’est pas non plus dans l’espace domestique. Elle est habillée en bourgeoise, porte une ombrelle, mène une vie de bourgeoise … Quelque part, elle domine les autres. Le sexe devient alors, sur l’échelle de promotion sociale, le dernier maillon à franchir.
Dans les colonies, qu’il soit interdit ou encouragé, le sexe est partout…
80% de ceux qui partent aux colonies -dans tous les Empires au XIXe siècle-, en tant que militaires ou fonctionnaires, sont des hommes. La colonie est perçue comme un territoire dangereux, peu à même de recevoir des femmes sauf quand celles-ci accompagnent leurs maris ou quand il s’agit de les punir ; ce fut le cas des prostituées que l’Angleterre envoya en Australie. Ce postulat, qui est à peu près valable pour tous les empires coloniaux, s’accompagne d’une logique militaire : quand une troupe part, l’alcool et les femmes doivent être là ; sans cela, dit-on, l’armée déprime et perd les batailles. Or, les têtes de pont des empires coloniaux ont très souvent été des marins ou des militaires, ils connaissent donc ce raisonnement et vont le mettre en place comme avec les BMC. Ainsi, on tolère que ces «voyageurs» puissent avoir une compagne dans les colonies, à condition de ne pas se marier. Parfois, cela va beaucoup plus loin : pour générer une population métisse qui servira d’intermédiaire à l’administration coloniale, les Italiens et les Portugais incitent les conquistadors à prendre une indigène pour épouse. Cette dernière ne vaut en rien, et surtout pas en droits, l’épouse restée au pays. Tous ces rapports se mettent en place dès les premières découvertes sur les côtes d’Afrique, des Indes et dans le Pacifique ; ils perdurent tout au long du XVe, XVIe et XVIIe siècle. L’accessibilité de la femme n’est plus un tabou, au contraire, cette dernière devient une offrande. Les contraintes et interdits émergent au XXe siècle, avec la pression des femmes blanches qui arrivent aux colonies et s’y installent, mais aussi avec les mesures de ségrégations et de séparations devant la présence visible des métis et le peur de voir l’édifice impérial s’effondrer. Sur les affiches de promotion coloniale, il y a d’ailleurs toujours une femme accueillant les hommes, mais celles-ci font déjà partie d’une mythologie. Dans le même temps, persiste l’interdit absolu : le mariage avec une indigène qui sous-entend la procréation et la reconnaissance de celui-ci que va rendre inacceptable la morale colonial. En 1928, le droit français va d’ailleurs poser la question le statut de ces enfants métis… Sont-ils français ou indigènes ? Un autre interdit demeure et ne s’effondrera qu’avec les années d’indépendance, l’alliance d’une blanche avec un colonisé ou, aux Etats-Unis d’une blanche avec un non-Blanc (Indien, Chinois, Afro-Américain…).
Quels sont les différents statuts, officieux ou officiels, de la femme indigène ?
Ces rapports, quoique constants en pratique, vont plus ou moins s’institutionnaliser selon les territoires. Aux Antilles ou dans les champs esclavagistes du Brésil, le droit esclavagiste va identifier la fonction de « femmes à maîtres ». Elles sont souvent des femmes reproductives puisque l’on considérait qu’un métis valait plus qu’un indigène. Dans les cantons coloniaux de l’Afrique de l’Ouest -jusqu’à aujourd’hui chez bon nombre de coopérants- une domestique, par exemple, était aussi considérée comme une offrande sexuelle. À côté de cela se développent des bordels à Blancs. Nous pouvons citer Bousbir, un quartier de Casablanca qui est totalement pensé comme un quartier de prostituées, réservé aux clients. Un monde sexué se structure, avec ses codes, ses règles, ses interdits … Ce qui est exceptionnel, c’est que la prostitution permet aux femmes de l’espace colonial du XIXe siècle de gagner de l’argent, ce qu’aucun autre métier ne leur permettait. Des populations féminines commencent à emmagasiner des richesses et développent une forme de pouvoir dans une société où les prostituées étaient plutôt à la marge ; bien que moins marginalisées que d’autres, puisque concubines de Blancs. Ce système-là s’institutionnalise au point de devenir un élément majeur de l’imaginaire colonial : si vous interrogiez un Français ou un Anglais en 1890 quant à la vie des femmes en pays musulman, il vous aurait répondu convaincu, qu’elles se promènent dénudées dans la rue ou dans les palais orientaux … Pour cause, des dizaines de milliers de cartes postales de l’époque représentent des mauresques aux seins nus. Partout dans les colonies, les hommes sont-là pour être mis au travail et les femmes, pour servir le Blanc. C’est valable pour l’Afrique de l’Ouest ou orientale, pour le Maghreb, le Moyen-Orient, l’Indochine, les Antilles. Tous ces univers fonctionnent sur le même mécanisme. Notons que le vocabulaire colonial est d’ailleurs très sexuel : la possession, la conquête, la domination…
Dans la fabrication de l’imaginaire, la photographie marque un tournant ?
Au XIXe siècle, la photographie bouleverse la pornographie parce que le réel remplace le dessin ; le réel s’impose au regard qui va chercher ce qu’il y a de plus étrange, de plus étonnant, de moins normé. En Occident, voir un homme blanc avec une femme noire, une femme blanche avec un homme noir ou encore un homme noir avec un homme blanc, relève de l’exceptionnel. Ces images qui arrivent des colonies vont surprendre et fasciner. C’est la pornographie avec tous les codes du XXe siècle qui se met en place ; une pornographie qui peut être aussi homosexuelle et souvent bisexuelle car cela amène encore plus d’interdit, encore plus de fantasmes qui sont toujours liés à l’exotisme. Dès lors, à partir des années 1880/90, la plupart des grands bordels en Europe et aux États-Unis se dotent systématiquement d’une femme noire ou orientale pour satisfaire leurs clients et apporter une « dose » d’exotisme. Le fantasme est passé par l’image et devient un produit de consommation.
Revenons sur le rapport hommes blancs et femmes colonisées…
Avoir un amant blanc permet d’acquérir un statut social différent, celui de «femme du maître». Nous savons, au niveau de l’esclavage ce que cela signifie. Il faut cependant le transposer au niveau colonial : un homme blanc qui n’a pas de maîtresse n’est plus un homme blanc parce qu’il n’est pas ou plus un «maître». Tous ces codes qui s’établissent dans ces rapports de domination vont imprégner les grands romans coloniaux de l’époque ; ils vont transformer cette littérature. De même, ils accompagnent les premières grandes expositions universelles et coloniales avec ces danseuses du ventre au rôle de nymphes envoutant les hommes. Les films L’Atlantideou La danseuse de Marrakech, mettent en valeur ces rapports de puissance, de suprématie et d’assujettissement : l’homme doit consommer la femme indigène sans pour autant tomber amoureux d’elle. S’il bascule dans l’émotion par envoûtement, la femme prend le pouvoir par le sexe et l’homme se perd dans l’autre monde. Ces rapports de dominations induisent de manière évidente un rapport au corps spécifique selon les populations. Alors qu’il est impensable de montrer un homme blanc torse nu pour vendre quelque produit, il est totalement normal d’exhiber un indigène dévêtu sur une affiche grand public puisque le corps de ce dernier n’a pas la même valeur. Dans l’histoire de la colonisation, le rapport au corps est omniprésent. C’est le corps que l’on puni lorsque l’on a fauté…
Comme les corps des Noirs mutilés aux États-Unis…
Oui, aux États-Unis, dans la plupart des lynchages qui ont eu lieu de 1875 jusqu’aux années 1930, les corps sont pendus, généralement gravement mutilés, cassés, blessés ; ils sont systématiquement brûlés ou castrés. En parallèle de ces fascinations, de ces érotisations du temps des colonies, il y a la punition de l’indigène qui a commis l’interdit absolu : la castration pour l’homme, le viol pour la femme. Cependant, comment expliquez-vous qu’en 1944, parmi tous les soldats qui avaient violé durant la Seconde Guerre mondiale, seuls les noirs furent pendus ? Ségrégation, violence, domination et fantasmes sexuels s’entrecroisent et écrivent ensemble une longue histoire des rapports entre les colonisateurs et les colonisés.
Recueilli par Marc Cheb Sun et Noé Michalon
Sexe, race et colonies, Éditions La Découverte, octobre 2018
Pour aller plus loin :
- Les nus des Mappelthorpe : http://www.mapplethorpe.org/portfolios/
- Les photos d’Ayana Jackson : http://www.ayanavjackson.com/portfolio
- Dans l’Express, commentaire d’un livre sur les squaws, les femmes indiennes d’Amérique http://www.lexpress.fr/culture/les-amerindiennes-des-femmes-avant-gardistes_1627060.html
- Une affiche de propagande coloniale : http://www.militarysunhelmets.com/wp-content/uploads/2012/03/voyagez.jpg
- Description du livre du Dr Jacobus https://www.abebooks.fr/rechercher-livre/titre/l’art-d’aimer-aux-colonies/auteur/jacobus-x-docteur/
- Article sur Bousbir, quartier de Casablanca où la prostitution était répandue dans le Maroc colonial
- Fiche du film La danseuse de Marrakech sur Allociné http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=9386.html
- Fiche du film l’Atlantide (1932) sur Allociné http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=7089.html
- Article du journal du CNRS sur les zoos humains
https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-lepoque-des-zoos-humains - Les ancêtres de Christian Karembeu exposés comme des animaux
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-choix-de-france-info/les-ancetres-de-christian-karembeu-exposes-comme-des-animaux-didier-daeninckx_1746301.html - Photographies de Thierry Le Gouès http://www.thierrylegoues.com/beauty-index.html
Sexe, race & colonies est un ouvrage dirigé par Pascal Blanchard , Nicolas Bancel (historien, université de Lausanne), Gilles Boëtsch (anthropobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS), Christelle Taraud (historienne, Columbia University et New York University), Dominic Thomas (spécialiste du post colonial).
En collaboration avec Rachel Jean-Baptiste, Jennifer Anne Boittin, Elisa Camiscioli, Sylvie Chalaye, Jean-Noël Ferrié, Arlette Gautier, Christine de Gemeaux, Olivier Le Cour Grandmaison, Sandrine Lemaire, Pierre Ragon, Alain Ruscio, Tracy Denean Sharpley- Whiting, Jean-François Staszak, Jérôme Thomas, Françoise Vergès.